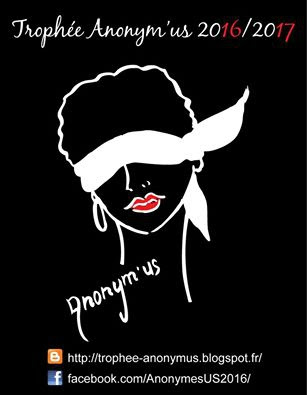Créé par
Anne Denost et Eric Maravelias
21ème semaine, 21ème nouvelle, dans 5 semaines le dénouement.
Le Parloir
Axel n’écoute pas.
On lui a bien appris pourtant, à ne pas mettre ses coudes sur la table mais ce sont ses bras tout entiers qu’il y pose et sa tête avec. Un œil est fermé par sa joue écrasée, l’autre suit les motifs du papier peint : des oursons coupés en plein milieu par les huisseries dont on a retiré les portes. Axel regarde au-delà des ouvertures béantes, dans ce couloir où les gens avancent sans s’arrêter. Ceux qui le regardent ne le voient même pas et dans quelques secondes ils l’auront probablement déjà oublié.
Axel se tortille sur sa chaise, son ventre le tiraille déjà mais cela n’a rien à voir avec la faim.
Maman ne tardera plus.
Axel se rend au parloir tous les mercredis.
Même s’il connait le chemin par cœur, Michel lui tient inévitablement la main pour le guider jusqu’à la petite pièce aux oursons bleus. Le même homme, qui chaque semaine lui demande son nom. Axel porte celui de son père, VANDAELE, et Michel l’écorche invariablement, comme s’il le faisait exprès.
Le père d’Axel est parti de la maison depuis presque deux ans. Il y a eu cette millième dispute dans le salon, et puis il est entré dans sa chambre et a embrassé son fils sur le front. L’enfant n’a pas grimacé en sentant la barbe dure piquer sa peau, il n’a rien dit et a continué à faire semblant de dormir. Quand la porte a claqué, seulement, il a fondu en larmes.
C’est de la faute de son petit frère, tout ça. Tout ce qui est arrivé, c’était à cause de Barnabé.
Une créature chétive flanquée d’un prénom ridicule, qui avait à peine soupiré en venant au monde ; un garçon maigre et jaune qui semblait laper l’air à grandes goulées dès qu’on l’abandonnait à l’intérieur de son couffin.
Axel avait dès lors considéré son frère comme un fardeau fragile, un boulet de verre encombrant qu’il devrait traîner avec soin jusqu’à ce que la chose soit capable enfin de se débrouiller seule. Il n’avait rapidement plus pu supporter le souffle rauque et embarrassant qui émanait de Barnabé. Cet écho caverneux qui s’extirpait avec peine de ses bronches pleines de poix.
Étrangement, la vieille chatte grise de la maison s’était immédiatement prise d’affection pour le bébé. Dès la première seconde, elle l’avait couvé des yeux et avait roucoulé près du berceau sans relâche. Elle avait léché son front humide, s’était roulée en boule près de lui et n’avait jamais cessé de ronronner au rythme des marées asthmatiques du bébé.
Lorsque Maman fermait la chambre afin de laisser dormir Barnabé, l’animal griffait le bois avec force, ne laissant jamais l’enfant trouver le sommeil. Il se mettait à geindre rapidement et les pleurs incommodaient la chatte qui ne supportait pas qu’on le laisse couiner de la sorte. Elle miaulait, hurlait comme lui, attendait que la porte s’ouvre pour courir le réconforter, l’embrasser, le goûter. Elle ne le quittait jamais, il était chaud, il ronflait comme elle.
Axel observait le cirque depuis sa chambre, cette attention vouée à une petite créature qui n’en valait pas la peine. Quand Axel pleurait on lui tendait juste un mouchoir, lorsqu’il demandait des baisers, on le repoussait. Il était grand maintenant, il n’avait plus besoin de tout cela, pourquoi est-ce qu’il les embêtait ?
Et puis un soir, comme un sort idiot, la voix du père avait fait taire la toux dégoûtante du petit frère. Il avait simplement conté une histoire, pour s’occuper peut-être ou bien juste pour couvrir les hoquets monstrueux... et voilà que le second fils s’était endormi immédiatement, sans le moindre ronflement. Le père, ravi, s’était mis à réciter tous les livres de la maison, jusqu’aux notices des appareils ménagers hors d’usage. Et ne trouvant bientôt plus de pages à tourner, il avait commencé à inventer : de nouvelles histoires, de nouvelles sonorités, des musiques jamais entendues, jamais lues. Barnabé s’était nourri jusqu’à l’os de cette voix grave, le père avait raclé ces cordes vocales jusqu’à les rendre plus vibrantes encore, plus tonitruantes. Des nuits durant, l’homme avait laissé courir son imagination et ses mots, déblatérant idioties et chuchotant histoires graves. Il avait parlé et parlé encore, créé princes et pirates, monstres et joyaux, maîtresses et amants, jusqu’à épuisement.
Axel lui, n’avait plus rien obtenu. Juste le droit d’écouter les miettes, depuis son lit. Alors il plissait ses yeux de toutes ses forces pour en avoir autant que possible. Il saisissait des phrases, ou parfois juste le son sourd et monocorde de la voix de son père. Il s’endormait de fatigue, lorsque sa concentration n’en voulait plus.
Et, quand même Barnabé avait cessé d’écouter, le père avait continué. Pour le souffle calme de l’enfant, pour les roulements félins sous sa main, pour ses propres oreilles qui en redemandaient.
La chatte, l’homme et le bébé demeuraient là jusqu’à ce que la nuit soit bien noire et que les oiseaux cessent de chanter derrière les fenêtres. Le père parlait sans s’arrêter, parfois jusqu’à ce que la lumière reparaisse, produisait le même bruit que le vent durant les nuits de tempête, ces vagues rassurantes qui berçaient la chambre. Sa voix réchauffait, ses mains caressaient. Barnabé respirait calmement ; la chatte l’entendait, l’écoutait, et s’endormait alors contre le couffin, lourde comme la pierre.
Sous les yeux d’Axel qui s’accroupissait parfois derrière la porte, le père aussi flanchait, assis sur une chaise grinçante, sa tête basculait en avant, trop lourde, pleine de vide. Il ronronnait lui aussi, se joignant aux deux autres dans un chant étrange de souffles mélangés. Alors les corps bougeaient, secoués de spasmes assoupis. Ils rêvaient en chœur, cauchemardaient de temps en temps pour s’éveiller du même sursaut. Et le cycle recommençait, la voix, les grognements de part et d’autre de la chambre, le calme. Ainsi de suite. Des nuits entières et parfois des journées. Axel sentait la tristesse prendre toute la place dans son estomac. Mais il ne savait pas la hurler. Il avait supplié qu’on s’occupe de lui, mais nul n’avait réagi.
Maman avait laissé faire, elle n’avait jamais pris le temps de s’attendrir sur l’un ou l’autre des enfants. Elle s’affairait aux autres tâches de la maison. Les lessives, les repas, les courses, le ménage. Elle quittait souvent le foyer dans ses vêtements de la veille pour aller acheter du pain, fumer ou prendre l’air, elle prenait souvent son temps. Elle aimait être seule.
Ce matin-là, lorsqu’elle était rentrée du marché, elle avait claqué la porte pour réveiller les fantômes, mais rien n’avait bougé. Axel ne s’était pas fait entendre, alors qu’il était toujours le premier debout.
Arrivée dans la cuisine, une bouteille en verre s’était échappée de l’un des sacs et s’était brisée, du lait s’était répandu sous le réfrigérateur. Par terre, il y avait des boites de conserve et quelques fruits amochés. Des tomates, surtout. Des tomates éclatées, et des pépins qu’il faudrait ramasser un à un.
Maman avait soudain perçu quelque chose. Elle n’aurait pas su l’expliquer, mais le silence était plus fort que jamais. Elle avait fermé les yeux et soupiré. Elle n’avait pas pressé le pas. Elle n’avait même pas jeté un œil dans la chambre d’Axel et s’était dirigée droit vers la chambre du bébé. La porte n’était pas verrouillée, et pourtant, elle avait eu bien du mal à l’ouvrir. Elle n’osait pas. Tétanisée. Derrière, elle avait entendu des chuchotements. Le père ne chuchotait jamais, le père parlait fort, il racontait, il débitait. Il ne murmurait pas.
Elle avait poussé la porte, d’abord regardé son mari endormi sur la chaise les mains jointes sur son ventre. Puis elle avait vu Axel bondir loin du couffin et avait lu dans ses yeux.
Du berceau, elle avait perçu le souffle léger qui s’échappait à intervalles réguliers. Alors, elle s’était demandé pourquoi Axel semblait si inquiet.
Maman avait donc regardé. Le couffin n’avait pas bougé, peut-être oscillé un peu. À l’intérieur, elle avait distingué le crâne et la chevelure éparse et blonde de Barnabé. Puis elle avait vu ce qui n’était pas Barnabé. Les oreilles d’abord, douces et arrondies, puis les pattes aux griffes dissimulées, appuyées contre les parois moelleuses. Elle avait regardé la toison grise et le ventre blanc se gonfler et se vider, affalé sur le visage du bébé.
Elle avait eu envie de vomir d’abord.
De courir aussi, mais elle n’avait pas eu la moindre idée d’où elle aurait pu s’enfuir.
Mais elle était restée là, hébétée, devant cette chatte qui ronronnait sur le bébé, sur Barnabé qui ne respirait plus. Cet enfant chétif et jaunâtre qui avait suffoqué parce qu’on avait pris soin de lui.
Maman avait contemplé le berceau sans jamais chasser le félin. Elle avait imaginé des tas d’issues et laissé filer secondes et minutes. Elle avait attendu que le bébé pâle bouge et pleure, mais il était resté inerte sous la fourrure chaude. Le père avait ouvert les yeux et s’était mis à hurler d’un coup, un long cri sourd et sans fin. On eut dit un animal. Maman avait sursauté. C’est à ce moment qu’elle s’était ruée pour composer le numéro des urgences. Comme si cela en valait encore la peine.
Axel s’était glissé dans le lit de ses parents cette nuit-là, il avait essayé de s’enrouler dans les bras de sa mère, mais elle n’avait pas réagi. Elle l’avait regardé comme un étranger. Pire qu’avant.
Après le départ des ambulances et de la Police, Maman avait tué la vieille chatte grise. Il faisait déjà jour, et le félin ronronnait encore. Elle l’avait saisie délicatement par la peau du cou, l’avait serrée, juste assez pour la soulever sans la faire miauler. Puis elle l’avait fourrée dans un sac de riz vide. La chatte n’avait pas émis le moindre son, couchée au fond du sac, manquant probablement déjà d’air et de place. Axel avait regardé sa mère sortir et s’avancer d’un pas tranquille dans l’allée brumeuse. Elle avait enjambé le parapet puis avait continué jusqu’au fond de la cour, devant le mur qui séparait les deux jardins voisins. Le couple qui habitait derrière était plutôt aimable et discret. Ils n’auraient pas dérangé une fourmi sur un brin d’herbe s’il avait fallu tondre la pelouse. Ils disaient bonjour et au revoir avec le même sourire bonhomme. Et c’est avec ce même sourire qu’ils présenteraient sans nul doute leurs condoléances. Quel terrible événement, nous vous avons préparé une tourte au fromage.
Maman avait levé le sac au-dessus de sa tête. La chatte n’avait pas bougé, elle s’était laissée faire. Elle avait confiance en cette femme qui ne pouvait pas lui faire de mal, elle ne lui en avait jamais fait.
Le sac n’avait tournoyé qu’une seconde, et s’était écrasé contre le mur. Une fois, puis deux, puis dix, et à aucun moment on n’avait entendu le moindre miaulement. La chatte s’était laissée tuer docilement, sans protester.
Maman avait jeté le sac dans le bac à ordures, puis elle était rentrée. Elle s’était lavé les mains avec force, les avait essuyées dans un torchon propre qu’elle avait jeté immédiatement à la poubelle. Puis elle avait allumé la télévision et s’était assise sur le canapé, épuisée. Axel n’avait rien dit. Son cœur avait battu la chamade tout le temps, mais il s’était tu. Aucun mot n’avait bien sonné à l’intérieur de son crâne, aucun n’aurait changé quoi que ce fût.
Il n’avait rien dit.
Mais elle savait tout.
Elle l’avait surpris près du berceau, sa main pas bien large encore posée sur les ronronnements de la vieille chatte, qui caressait pour féliciter. Maman avait vu Axel tuer son frère, et ce bruit presque imperceptible qui s’était échappé de la chambre, elle l’aurait reconnu entre mille, c’est Axel qu’elle avait entendu ricaner.
Mais elle n’avait rien dit. Elle n’avait pas crié, ne l’avait pas puni, ne l’avait pas rassuré non plus. Elle ne lui avait simplement plus adressé le moindre mot.
À l’enterrement de Barnabé, elle s’était tenue loin d’Axel, elle avait toujours gardé deux ou trois personnes entre eux pour ne pas croiser son regard. Axel l’avait cherchée pourtant, il avait tenté de saisir sa main mais elle s’était mollement dérobée et avait disparu dans les bras d’autres gens éplorés qui l’avaient cajolée des heures durant.
Papa était parti quelques semaines après cela. Les parents n’arrêtaient pas de crier l’un contre l’autre, de toute façon. Des reproches ridicules, un plat trop cuit, de l’eau trop froide, de la poussière sous les lits : les disputes faisaient ventre de tout. Le père a quitté la maison en déposant ce seul baiser sur le front d’Axel, sans adieu. Et le silence avait de nouveau envahi la maison, pesant à faire courber le dos de Maman et de son fils.
Elle criait de temps en temps pour que le bruit remplisse les murs, elle ouvrait les fenêtres aussi, mais rien n’y faisait, le silence était toujours là. Parfois la nuit, Axel sentait son ombre, il devinait les mains tremblantes au-dessus de sa tête et de son cou, mais elle ne le touchait jamais.
Au bout d’un mois, elle avait pris le téléphone et composé un numéro à deux chiffres. Elle avait parlé longuement et Axel n’avait pas tout entendu. Simplement que c’était elle, qu’elle avait tué Barnabé, qu’il fallait l’emmener loin de là, sinon elle recommencerait. La Police était arrivée tranquillement, deux agents au crâne rasé qui avaient menotté sa mère et dit à Axel de rester dans sa chambre et d’être un bon garçon. Il était resté. Il avait regardé. Sa mère ne s’était pas défendue et ne l’avait pas embrassé avant de quitter la maison. C’étaient les services sociaux qui étaient venus le chercher. Une grosse femme qui lui avait tendu une sucette. Mais Axel se fichait des friandises, il voulait sa Maman. Juste sa Maman.
Axel vient voir Maman toutes les semaines. Et quand elle entre enfin dans la petite pièce aux oursons bleus et s’assoit face à lui, il se met à sourire. Elle ne dit rien, ne le touche pas. Elle évite de le regarder car tout en lui la révulse. Mais elle est là, il l’a tout entière pour lui, une heure par semaine le mercredi.